Étude de marché : l’arme secrète pour diminuer les risques d’échec

La première cause d’échec des jeunes entreprises n’est ni le manque de compétences, ni le manque de fonds, mais le fait de développer un produit ou un service dont personne ne veut. Surprenant ? Pas tant que ça ! On vous explique, avec un exemple concret.
Pourquoi faire une étude de marché
En tant qu’entrepreneuse ou entrepreneur, on est très souvent « amoureux » de son idée ! Cet enthousiasme pousse à avancer tête baissée, sans réellement vérifier l’existence d’une demande au-delà de ses propres certitudes. Vos futurs clients ont-ils vraiment besoin et/ou envie de votre solution ? Vous en êtes convaincu, mais est-ce vraiment le cas ?
L’étude de marché vous oblige justement à prendre du recul et à confronter vos convictions à la réalité du terrain. Souvent perçue comme scolaire, voire fastidieuse, c’est en réalité votre meilleur filtre anti-gaspillage : elle vous révèle rapidement si vous devez avancer, pivoter ou stopper — et donc éviter de perdre du temps, de l’énergie et de l’argent.
L’étude de marché a quatre objectifs
- Évaluer l’intérêt réel de vos potentiels futurs clients;
- Estimer le volume vendable;
- Tester un niveau de prix crédible;
- Engager vos premières démarches commerciales.
En pratique, vos intuitions forment la matière brute, et l’étude de marché est l’outil qui permet de les transformer en hypothèses claires, puis de les tester pas à pas pour vérifier si elles tiennent face à la réalité.
Attention : ne déléguez pas cette étape-clé ! Faire son étude soi-même est essentiel : c’est en allant sur le terrain qu’on comprend vraiment ses clients, qu’on découvre ce que les chiffres seuls ne disent pas et qu’on peut ainsi capter les nuances qu’une agence ou un intermédiaire risquerait de rater.
Pour illustrer cet article, prenons un exemple concret à Genève qui servira de fil rouge.
Notre idée ? Développer une plateforme de garde partagée pour enfants, qui met en relation des familles d’un même quartier pour organiser des gardes collaboratives.
L’étude de marché étape par étape
Étape 1 : Étudier l’offre (la concurrence)
Avant même d’étudier la future clientèle, regardez ce que le marché propose déjà. Il s’agit d’étudier la concurrence directe (même besoin client, même solution) et la concurrence indirecte (même besoin client, solution différente).
Dans notre exemple :
- Concurrence directe: crèches privées, garderies, nounous, plateformes de babysitting existantes.
- Concurrence indirecte: famille, voisins, arrangements informels entre parents, ou tout simplement « se débrouiller ».
Après les avoir identifiées, menons une analyse afin de comprendre l’environnement concurrentiel dans lequel nous allons nous inscrire :
- Commencez par lister les facteurs clés de succès du secteur, c’est-à-dire étudier les éléments essentiels sur lesquels les clients basent leurs décisions d’achat. Dans notre exemple, cela pourrait être la confiance, la sécurité, la flexibilité horaire, le coût, la proximité géographique… Vous pouvez trouver ces critères en questionnant directement leur clientèle (sur place, via des événements, etc.) puis en analysant les retours clients sur les canaux digitaux (avis Google, commentaires sur les réseaux sociaux, etc.).
- Ensuite, cartographiez les positionnements de ces concurrents, en réalisant un mapping concurrentiel sur deux des critères ci-dessus qui comptent le plus pour vos clients (ex. prix ↔ flexibilité). Placez crèches, nounous, plateformes, arrangements informels… et n’oubliez pas de positionner votre propre idée, qui doit idéalement se situer dans un espace inoccupé.
Prenez le temps de mener cette analyse de manière rigoureuse, car elle est absolument stratégique pour la suite.
Étape 2 : Étudier la demande (les clients)
Une offre n’a de valeur que si quelqu’un la veut maintenant et paie pour l’obtenir. Il s’agit donc de vérifier que la demande est bien là. Dans notre exemple, voici l’hypothèse de départ : « les parents ont un vrai problème de garde et sont prêts à tester une alternative ». Combinez deux approches pour explorer cette supposition.
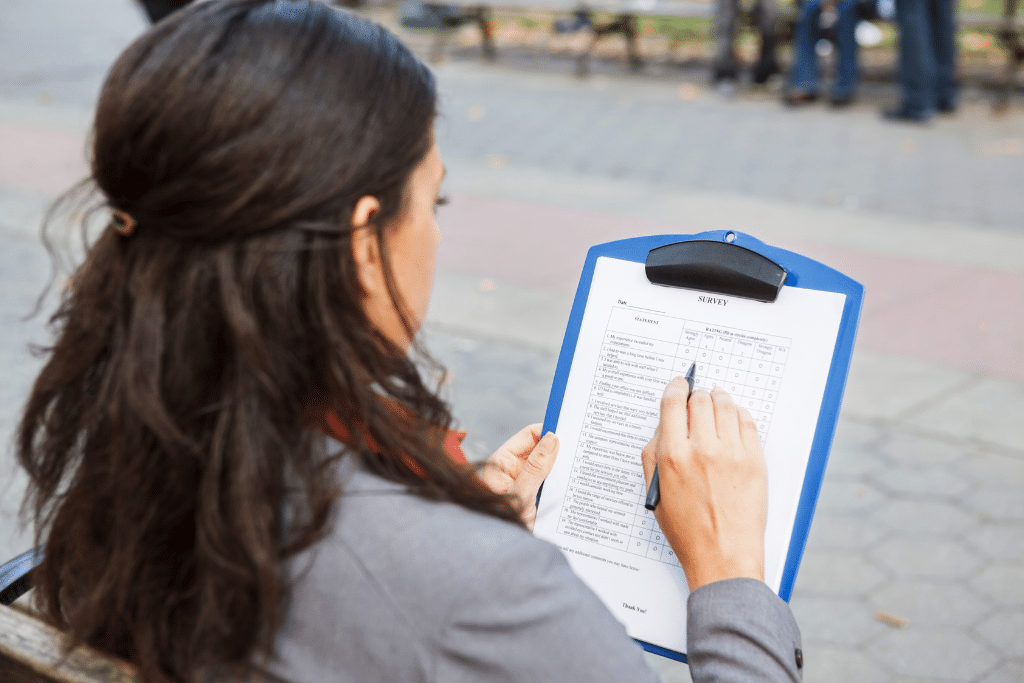
1) Etude qualitative : comprendre en profondeur
Commencez par une étude de marché qualitative. Cette méthode exploratoire, basée sur un petit nombre de potentiels clients, s’appuie sur des entretiens individuels et/ou des groupes de discussion (“focus groups”). Son but ? Creuser le problème supposément rencontré par vos clients potentiels. L’enjeu est de comprendre vos clients en profondeur, dans toute la complexité de leurs contraintes, habitudes et motivations.
Dans notre exemple, nous réalisons 15–20 entretiens avec des parents genevois pendant un mois. Allez à la rencontre de ces personnes dans les lieux qu’elles fréquentent: dans les files d’attente de crèches, via des associations de quartier, ou à travers des groupes Facebook. Évitez d’interroger la famille et les amis proches, afin de ne pas fausser vos conclusions. Privilégiez plutôt des personnes extérieures à votre cercle, comme des amis d’amis, qui constituent un bon compromis.
A travers ces courts échanges (par exemple 10 minutes, à adapter selon l’interlocuteur et le contexte), cherchez à comprendre leurs attentes (proximité du lieu de travail, type d’activités proposées aux enfants…) ainsi que leurs difficultés : horaires incompatibles, coûts élevés, manque de places, besoin de confiance. Échangez plus largement autour de leur situation personnelle, de leurs routines, de leurs impératifs, de leurs aspirations. Questionnez jusqu’à ce que vous n’appreniez plus rien de nouveau !
En regroupant ces témoignages (par exemple : « j’ai attendu 12 mois pour une place », « trouver une nounou qui accepte de se déplacer est très compliqué », « j’ai peur de confier mon fils à un-e inconnu-e », etc.) vous parviendrez ainsi à identifier des thèmes récurrents qui viendront étoffer votre hypothèse de départ.
Vous pouvez également déjà sonder la perception de la valeur afin d’étudier le prix: demandez aux parents combien ils dépensent actuellement, quelles dépenses de garde ils jugent chères ou abordables, et ce qui les ferait changer de solution.
Exemple de questions pour cette étude qualitative :
Inspirée du Mom Test – une méthode qui aide à poser des questions honnêtes et non biaisées – voici un exemple d’entretien pour notre cas de plateforme de garde partagée.
Points de vigilance
Lors des discussions, soyez attentif·ives aux réactions de vos prospects :
–Compliments (« Super idée ! ») : ne les confondez pas avec une réelle intention de payer.
–Promesses (« Je m’inscrirai ») : une déclaration d’intention n’est pas un engagement concret.
–Réponses superficielles (« Ça se passe souvent bien »): relancez et demandez toujours “pourquoi” ainsi que des exemples précis pour creuser.
–Réactions non verbales : observez aussi le langage corporel, les mimiques, les silences, les hésitations ou l’enthousiasme spontané, qui donnent souvent des signaux plus fiables que les mots seuls.
–“Say–do gap” : ce que les personnes interrogées disent peut être très différent de ce qu’elles font réellement (par exemple : déclarer vouloir un service collaboratif mais continuer à payer une nounou à la maison pour éviter que son enfant ne tombe malade).
2) Etude quantitative: mesurer à l’échelle
Après avoir identifié les enjeux animant vos prospects grâce à l’étude qualitative, transformez-les en hypothèses chiffrées et testez-les par la méthode quantitative. Le but? Les (in)valider avec un échantillon représentatif plus conséquent.
Dans notre cas, imaginons que nous créons et diffusons un questionnaire en ligne auprès de 300 parents genevois. Mais attention : 300 réponses non ciblées ne valent rien. La qualité de l’échantillon prime sur la quantité. Pensez à intégrer quelques questions de qualification pour vérifier la pertinence des répondant·es (par exemple: « Où habitez-vous ? », « Avez-vous des enfants ? », « Quels âges ont-ils ? »). Ces filtres garantissent que vos données proviennent bien du bon public, et que vos résultats soient réellement exploitables.
Sur la base des hypothèses préétablies à travers l’étude qualitative, nous pourrions mesurer à travers une quinzaine de questions:
- Fréquence des difficultés de garde
- Budget mensuel disponible
- Solutions actuelles utilisées
- Critères de choix prioritaires (coût, flexibilité, proximité, confiance)
- Intérêt pour une solution de garde collaborative
N’oubliez pas de tester le prix : avec cet exemple, nous pourrions demander à partir de quel prix le service de garde partagée leur semble trop cher, trop bas, acceptable, ou avantageux. On obtient ainsi une fourchette réaliste permettant de valider ou d’invalider l’hypothèse de prix.
Pour illustrer concrètement cette démarche, vous pouvez consulter l’exemple de questionnaire sur la garde partagée et le tester.
Bonnes pratiques de formulation
La qualité de vos questions détermine la qualité de vos réponses. Évitez :
Introduction biaisée (« Je développe une nouvelle solution collaborative pour la garde d’enfants »). Concentrez-vous sur le contexte et n’indiquez pas d’ores et déjà votre solution (« Je m’intéresse aux enjeux de la garde d’enfants à Genève »).
–Jargon. Utilisez un langage compréhensible de toutes et tous plutôt que des termes techniques qui pourraient fausser la réponse.
–Questions imprécises (« Que pensez-vous de ce service ? »). Préférez « La dernière fois que vous avez eu ce problème, comment l’avez-vous résolu ? ».
–Questions orientées (« C’est pratique, non ? »). Restez neutre pour ne pas biaiser la réponse.
–Questions à deux dimensions (« Est-ce utile ET abordable ? »). Traitez une notion à la fois pour obtenir des réponses pertinentes et utilisables.
–Questions fermées uniquement (oui/non). Complétez en creusant les « Pourquoi ? »
–QCM incomplets. Ajoutez toujours « Autre, précisez ».
Étape 3 : Choisir son segment prioritaire
Un segment client est un groupe homogène de clients potentiels qui partagent des besoins, des caractéristiques ou des comportements similaires. Segmenter permet de ne pas viser tout le monde à la fois, mais de concentrer vos efforts et votre budget sur celles et ceux qui sont le plus enclins à adopter votre solution.

À travers notre étude de marché, deux groupes de clients potentiels ont émergé avec des besoins affirmés :
- Parents actifs avec enfants 1–3 ans : gros problème de places en crèche, budgets élevés mais horaires contraints.
- Parents d’enfants 4–8 ans : besoin ponctuel en soirée ou le mercredi, budgets plus restreints mais recherche de flexibilité.
A présent il faut décider où concentrer les efforts. Pour choisir, voici quelques critères à prendre en compte :
- Importance du problème : à quel point ce segment souffre-t-il vraiment du problème identifié ?
- Impact de la solution : votre offre changerait-elle réellement la donne pour eux ?
- Taille du marché : combien de clients potentiels dans cette catégorie ?
- Disponibilité à payer : ont-ils un budget suffisant et une volonté de payer ?
Dans notre exemple, imaginons que notre étude de marché indique que le segment des parents actifs avec enfants 1–3 ans est prioritaire : le problème étant plus aigu (manque important de places en crèche), la recherche de solution est donc très active ; le budget disponible est similaire mais la disposition à payer est plus marquée. Les parents d’enfants 4–8 ans restent un segment intéressant à explorer plus tard, mais l’urgence et la valeur perçue sont moindres.
Attention : dans votre compréhension de la demande, distinguez bien le client (celui qui paie) de l’utilisateur (celui qui se servira de votre produit ou service). Une offre peut séduire l’utilisateur mais échouer si le client ne voit pas la valeur, et inversément. Prenez également en compte le décisionnaire (celui qui fait le choix) et le prescripteur (celui qui influence la décision).
Dans notre exemple, le client n’est pas seulement « les parents » au sens large : selon les familles, c’est souvent l’un des deux qui tranche pour les dépenses de garde, tandis que l’autre joue plutôt un rôle d’aide à la décision.
Conclusion
Une étude de marché, ce n’est pas juste cocher des cases pour un business plan ou une demande de financement : c’est une vraie démarche entrepreneuriale. De l’offre à la demande, du volume au prix, chaque étape valide (ou invalide) une intuition. Et au final, vous savez si votre projet mérite votre temps, votre énergie et votre argent.
Et après ? Il reste à évaluer la rentabilité de votre idée grâce au modèle TAM, SAM, SOM – une approche qui vous aide à estimer la taille totale du marché, la part réellement accessible et celle que vous pouvez viser à court terme.